Communication à caractère publicitaire

MARIAGE, PACS, CONCUBINAGE
Quelles différences
en matière de transmission ?
Lorsque l'on parle de couple, on vise deux personnes qui ont fait le choix de s'unir en se mariant, en se pacsant ou bien en vivant en concubinage. S'unir, c'est également épargner pour financer des projets de vie. Dès lors, que se passe-t-il lorsqu'un décès intervient ? Alexandra Bertrand, Responsable du Conseil Patrimonial Service Affinité BNP Paribas, revient sur les droits du survivant selon la forme juridique d'union adoptée.
Pouvez-vous nous rappeler les différences entre le mariage, le Pacs et le concubinage ? A.B. : ce sont 3 modes de conjugalité bien distincts. Si le mariage et le Pacs supposent des droits et des obligations, le concubinage, également appelé "union libre", est une forme d'union qui n'est pas formalisée et qui ne confère donc aucune obligation, ni aucun droit.
Le mariage est l'union légale de 2 personnes à l'occasion d'une cérémonie solennelle reçue par un officier d'état civil. Qui dit mariage, dit régime matrimonial fixant les droits et les devoirs des mariés. Si ces derniers n'ont pas signé de contrat de mariage, ils relèveront alors automatiquement du régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Il est cependant possible de rédiger, préalablement à la cérémonie, un contrat de mariage auprès du notaire pour aménager le régime légal ou bien encore choisir un autre régime matrimonial mieux adapté aux futurs époux.
Le Pacte civil de solidarité (Pacs) résulte, quant à lui, d'une convention conclue par 2 personnes pour organiser leur vie commune. Depuis 2007, si rien n'est précisé dans le contrat de Pacs, le régime par défaut est celui de la séparation des patrimoines. Toutefois, il est possible d'ajouter une mention expresse dans la convention, permettant aux partenaires de Pacs d'opter pour le régime de l'indivision.
Le concubinage, enfin, est une union entre 2 personnes qui n'ont aucune obligation l'une envers l'autre et ne sont pas liées par des règles juridiques. Elles seules définissent les modalités de leur vie commune. Sur le plan juridique, elles sont considérées comme étrangères l'une de l'autre et ne bénéficient, sauf à avoir pris des dispositions particulières, que d'une protection juridique limitée.
En matière de décès, existe-t-il des différences selon que l'on soit marié ou pacsé ?
A.B. : le mariage et le Pacs n'offrent pas les mêmes garanties car le partenaire pacsé est moins bien protégé en cas de décès de son partenaire. En effet, en l'absence de mesure particulière, les partenaires de Pacs ne sont pas héritiers l'un de l'autre.
Considéré comme un tiers, le partenaire pacsé ne peut prétendre à aucun droit sur la succession. Ce n'est pas le cas pour des personnes mariées : la loi attribue des droits spécifiques au conjoint survivant et ce, quel que soit le régime matrimonial du couple.
Pour un couple marié, si aucune disposition n'a été prise de son vivant, et en présence uniquement d'enfants communs, le conjoint survivant peut choisir d'hériter en usufruit à hauteur de 100 % ou bien en pleine propriété à hauteur d'1/4.
Cependant, il est rare que ces droits se suffisent à eux-mêmes. C'est pourquoi, que l'on soit marié ou pacsé, d'autres dispositions peuvent être prises
Quelles sont les solutions qui permettent de rapprocher ces 2 régimes et protéger ainsi son conjoint ou son partenaire de Pacs ?
A.B. : pour les couples mariés, l'une des solutions consiste à faire une donation au dernier vivant. Cet acte permet d'augmenter la part du conjoint survivant dans l'héritage en pleine propriété et/ou en usufruit. Attention toutefois, bien qu'elle offre davantage d'alternatives au conjoint survivant, elle n'est pas toujours opportune selon les objectifs et la composition familiale.
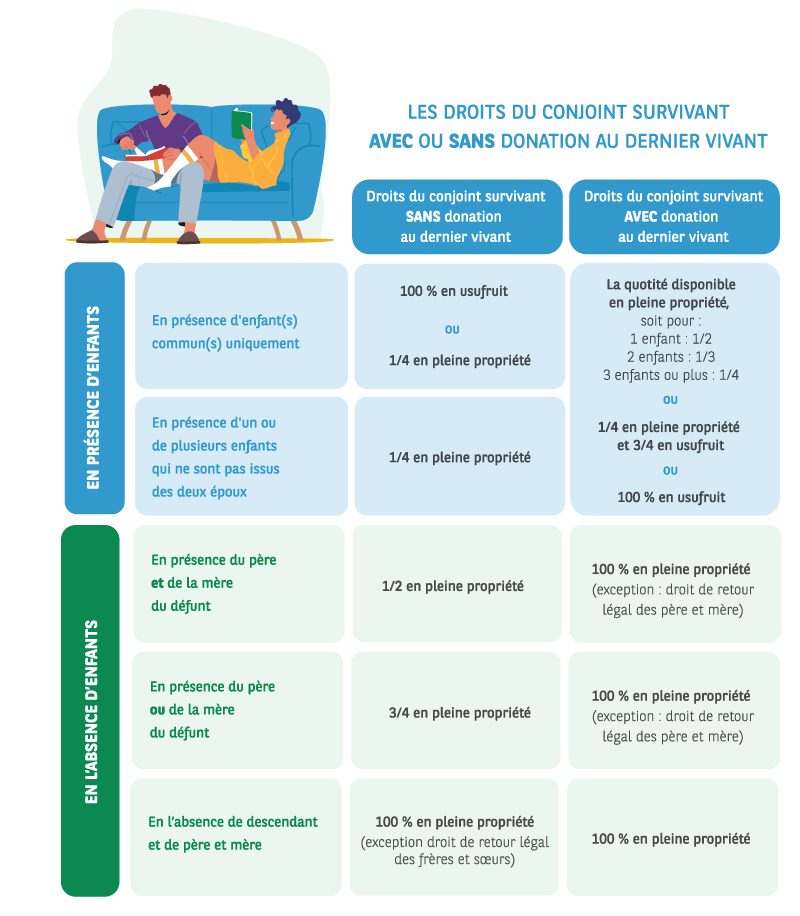
Quant à eux, les partenaires de Pacs doivent impérativement rédiger un testament car, dans le cas contraire, ils n'auront aucun droit dans la succession de leur partenaire. Là aussi, la part du patrimoine reçue dépendra de la composition familiale du défunt. En présence d'enfants, le testament permettra de léguer une quote-part du patrimoine dans la limite de la quotité disponible (part des biens dont le conjoint peut disposer librement).
En ce qui concerne le logement familial, mariés et partenaires de Pacs sont-ils sur le même pied d'égalité ?
A.B. : non. Là encore, le mariage accorde une plus grande protection au regard du droit du logement occupé par le couple marié.
En cas de décès du conjoint, la loi accorde automatiquement et gratuitement au conjoint survivant un droit temporaire sur la résidence principale : il ne peut en être privé. D'une durée d'un an, il s'accompagne également de la possibilité de conserver le mobilier du logement.
S'il en manifeste la volonté dans un délai d'un an à compter du décès, il peut demander à convertir ce droit temporaire en un droit viager d'habitation et d'usage. Cependant, cette possibilité n'est envisageable que si le logement familial était la propriété exclusive du défunt ou des 2 époux. Le conjoint survivant pourra alors bénéficier, jusqu'à son décès, et même en cas de remariage, d'un droit d'habitation sur le logement et d'usage sur les meubles qui le garnissent. La valeur du droit viager s'imputera alors sur les droits de succession du conjoint survivant mais, en cas d'excès, aucune indemnité ne sera due à la succession par le conjoint survivant.
Si le conjoint survivant ne peut rester dans le domicile du couple, ce droit temporaire sur le logement peut alors être converti en rente viagère ou en capital. Le conjoint survivant peut également bénéficier, sous conditions, d'un droit d'attribution préférentielle sur le logement. Il est par ailleurs possible de priver le conjoint du droit viager ou de le limiter dans le temps par testament authentique.
Si les époux étaient locataires de leur résidence principale, le bail est automatiquement transféré au conjoint survivant et les loyers sont payés par la succession pendant un an.
Et pour les partenaires de Pacs, que se passe-t-il pour le logement ?
A.B. : le partenaire pacsé ne dispose que d'un droit de jouissance qui lui permet de rester une année dans la résidence principale. Contrairement au mariage, ce droit n'est pas d'ordre public et il peut en être privé par testament.
À l'inverse, le testament permettra d'assurer à son partenaire de maintenir son cadre de vie en prévoyant, par exemple, qu'il hérite du logement familial ou, a minima, qu'il puisse bénéficier de l'usufruit ou encore d'un droit d'usage ou d'habitation sur le bien afin qu'il puisse rester dans l'habitation. Cependant, s'il existe des héritiers réservataires (des enfants), les dispositions prises en faveur du partenaire de Pacs ne doivent pas se heurter à leur réserve héréditaire.
Le partenaire de Pacs peut bénéficier, sous conditions, d'un droit d'attribution préférentielle sur le logement.
Abordons maintenant l'aspect fiscal. Des différences sont-elles à noter entre personnes mariées et pacsées ? Qu'en est-il pour les pensions de réversion ?
A.B. : il n'y a aucune différence de traitement entre les couples mariés et les partenaires pacsés en matière d'impôts (impôt sur le revenu, Impôt sur le fortune immobilière) car ils forment un seul foyer fiscal soumis à imposition commune, en principe.
C'est également le cas au regard des droits de succession car ils bénéficient, dans un cas comme dans l'autre, d'une exonération totale de droits.
En revanche, cette similitude de traitement ne se retrouve pas pour les pensions de réversion. En effet, en cas de décès du partenaire, le partenaire pacsé survivant ne bénéficie pas des pensions de réversion versées par la Sécurité sociale et les régimes complémentaires de son partenaire défunt. La retraite de réversion ne peut en effet profiter qu'aux conjoints mariés, sous conditions.
Enfin, j'ajoute que la question fiscale est un véritable enjeu pour les concubins ni mariés, ni pacsés, car si une disposition testamentaire peut permettre à l'un d'hériter de l'autre (dans la limite du respect des règles de réserve héréditaire), les droits à acquitter seront ceux entre non-parents, soit 60 %.
Pour vivre en couple sereinement, si l'on a le souci de la protection de l'autre en cas de décès, il est essentiel d'anticiper en choisissant un mode de conjugalité adapté. Pour cela, il convient de se rapprocher de son notaire, interlocuteur privilégié sur ces aspects, afin qu'il examine les solutions adaptées à chaque situation.
BNP Paribas, Société anonyme au capital de : 2.261.621.342 € - Siège social : 16 boulevard des Italiens - 75009 Paris. RCS : Paris 662 042 449 - Identifiant CE TVA : FR 76662042449 - N° ORIAS 07 022 735 www.orias.fr.

